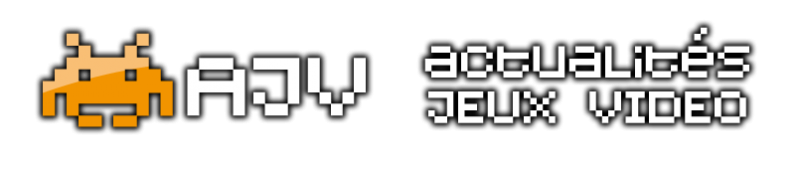Creation of the Gods II: Demon Force
Avec Creation of the Gods II: Demon Force, deuxième opus de sa trilogie inspirée du Fengshen Yanyi (ou Investiture des dieux), le réalisateur chinois Wu Ershan prolonge son projet cinématographique titanesque : faire entrer la mythologie chinoise dans l’imaginaire cinéphile mondial par le prisme du grand spectacle narratif, sans sacrifier ni la complexité de la matière originale ni les codes d’un cinéma populaire de qualité.
Le film reprend l’intrigue là où le premier volet s’était arrêté : l’ascension du roi Zhou (Fei Xiang), tyran brutal manipulé par la démone Daji (Naran), et la résistance menée par les immortels et les derniers princes fidèles à l’ancien ordre. Si Kingdom of Storms posait les jalons d’un monde en déséquilibre, Demon Force en explore les conséquences tragiques. Le film épouse une structure plus sombre, presque shakespearienne, multipliant les trahisons, les renoncements, et les dilemmes moraux déchirants. Le personnage de Yin Jiao, l’un des fils du roi Zhou élevé par les immortels, se détache comme figure centrale. Son parcours, construit sur une tension entre filiation et transcendance, convoque des archétypes puissants – le fils prodigue, le héros sacrificiel – tout en échappant à la simplification : il doute, il échoue, il se relève. À travers lui, Wu Ershan interroge la notion de destin, mais aussi celle de libre arbitre face à un système corrompu jusqu’à l’os. Le récit, dense et parfois labyrinthique, est ponctué de moments de pure intensité visuelle et dramatique – l’assaut d’un palais céleste, le dialogue tendu entre un père devenu tyran et un fils devenu ennemi, ou encore les visions cauchemardesques provoquées par la magie noire de Daji. Cette fragmentation du récit épouse une logique de l’épopée plus que celle du drame classique : il ne s’agit pas de suivre une intrigue linéaire, mais de traverser un monde en chute, où le sacré et le politique se confondent.
Wu Ershan ne filme pas la mythologie comme une simple succession d’actions héroïques : il la sculpte. Chaque plan semble pensé comme une peinture vivante, inspirée tantôt de l’art classique chinois (notamment les peintures de la dynastie Song), tantôt du cinéma épique des années 1960 (Ben-Hur, Lawrence d’Arabie), tantôt de la high fantasy contemporaine. La direction artistique est particulièrement remarquable. Les décors, qu’ils soient naturels ou numériques, composent un monde à la fois réaliste et onirique. Le royaume du roi Zhou, doré, écrasant, déshumanisé, tranche avec les espaces célestes des immortels, baignés dans une lumière bleue presque liquide. Ces choix chromatiques traduisent des états d’âme plus que des lieux : l’oppression, la corruption, la quête de lumière dans les ténèbres. Les effets spéciaux, s’ils sont parfois inégaux dans leur intégration, témoignent d’un véritable souci d’invention visuelle. Contrairement à nombre de blockbusters qui sombrent dans la surenchère numérique, Wu Ershan les utilise pour souligner des tensions narratives ou symboliques, non pour les masquer. La musique, signée par Gordy Haab, accompagne cette ambition avec une partition mêlant instruments traditionnels chinois, percussions tribales et envolées symphoniques. Elle confère au film une respiration ample, tout en accentuant la tension dramatique de plusieurs séquences clefs – notamment dans les scènes de combat ritualisé, traitées comme des chorégraphies tragiques.
Au-delà de la réussite formelle, c’est sans doute la portée symbolique du film qui impressionne le plus. En s’appuyant sur le Fengshen Yanyi, Wu Ershan s’approprie un récit qui a traversé les siècles, le remodelant comme un miroir critique de la Chine d’aujourd’hui. Le roi Zhou n’est pas seulement un despote mythique ; il est aussi une figure de la dérive autoritaire, de l’hubris masculin, de l’effondrement moral des élites. La lutte des immortels pour restaurer l’équilibre cosmique évoque, en creux, le désir de justice, de réconciliation entre traditions spirituelles et aspirations modernes. Le film peut ainsi se lire comme une allégorie politique voilée, une tentative de repenser le rapport au pouvoir, au sacré, à la mémoire culturelle dans un pays où ces questions restent sensibles. Cette lecture, subtile mais palpable, confère à Demon Force une profondeur supplémentaire, le plaçant aux antipodes d’un divertissement creux.
Tout n’est pas parfait dans Demon Force. La multiplicité des personnages secondaires, le rythme parfois inégal, et certains dialogues explicatifs alourdissent par moments le propos. Il faudra attendre le troisième volet pour juger pleinement de la réussite globale de la trilogie. Mais ce deuxième épisode confirme déjà une chose : Wu Ershan ne cherche pas à simplement “adapter” un mythe – il tente de le réincarner à l’écran, de lui redonner sa charge émotionnelle, politique, spirituelle. Dans un paysage cinématographique souvent formaté, Creation of the Gods II fait figure d’exception : un film spectaculaire mais exigeant, enraciné mais universel, traversé par un souffle rare. Un geste de cinéma à la fois ancien et profondément contemporain.