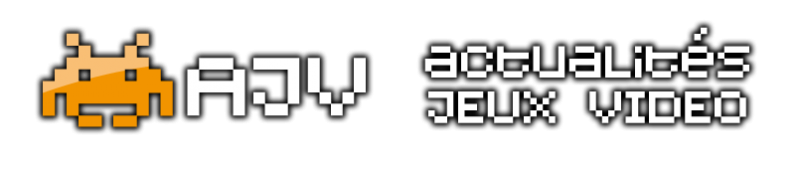Donkey Kong Bananza
Il arrive parfois qu’un jeu ne cherche pas à dominer sa génération, mais simplement à l’ouvrir. Qu’il ne prétende pas tout réinventer, mais qu’il désigne un chemin. Donkey Kong Bananza, premier vrai titre d’envergure exclusif à la Nintendo Switch 2, appartient à cette catégorie de jeux fondateurs — non parce qu’ils imposent un standard, mais parce qu’ils dessinent une promesse. Ce n’est pas un manifeste, c’est un levier. Et c’est peut-être ce qui le rend si important : il ne fait pas étalage de ses intentions. Il les plante, les enfouit, les laisse germer dans une matière de jeu qui privilégie l’adhérence au spectaculaire, la cohérence au show. Il faut creuser. Mais ce que l’on y trouve vaut l’effort.
https://difmark.com/r/DonkeyKongBananzaNintendoSwitch2Account5968
Profitez de 10% de réduction avec le code « DIFMARK » !
Dès l’écran titre — un plan fixe sur les cimes brumeuses d’Ingot Isle, dénué de menu intrusif — le ton est donné : pas de jaillissement orchestral, pas de mascotte surexcitée. Un monde, juste là, en attente d’être entamé. Et cette tension contenue, presque silencieuse, traversera tout le jeu. Donkey Kong Bananza n’est pas un jeu de jaillissement. C’est un jeu de percussion lente, de désobstruction patiente, d’exploration verticale et d’attache progressive. On ne tombe pas amoureux d’un coup. On s’y lie, couche après couche, comme on apprivoise une matière nouvelle.
Tout commence avec un coup de poing. Pas un uppercut flamboyant, mais une frappe dense, volontaire, qui fait vibrer le sol. Le monde réagit : les blocs se fissurent, les murs se délitent, les cavités s’ouvrent. Car ici, le terrain n’est pas un décor. C’est le sujet. Bananza fait le pari rare d’un monde entièrement destructible, non pour flatter l’œil, mais pour contraindre le corps du joueur à adopter une nouvelle posture : plus basse, plus appliquée, plus déterminée. Ce n’est plus l’élan qui mène, mais la pression. On pousse, on arrache, on absorbe. On sculpte son chemin dans un relief qui oppose toujours une forme de résistance.
Cette destructibilité n’est pas gratuite. Elle s’inscrit dans une logique systémique où chaque transformation — obtenue au contact de “Giant Elders” disséminés dans les profondeurs de l’île — vient déverrouiller une grammaire propre. L’autruche, bondissante et planeuse, permet d’évoluer au-dessus des gouffres instables. Le zèbre dévale les pentes en spirale. L’éléphant pulvérise, mais écrase aussi certaines plateformes par mégarde. Le serpent, fluide et silencieux, se glisse là où toute autre forme bute.
Mais plus qu’un catalogue de pouvoirs, ces transformations dessinent une mécanique d’identité mouvante. Elles forcent le joueur à adapter son rapport à l’espace, à envisager différemment la manière d’aborder chaque strate. Elles sont à la fois outils et choix, et leur utilisation influe subtilement sur la perception de l’île elle-même. Là où d’autres jeux segmentent leur monde par zones et biomes, Bananza propose un monde stratifié, continuellement traversé, redécouvert à la faveur d’une nouvelle capacité.
Ingot Isle n’est pas un hub. C’est un corps vertical, un monument fracturé dont on explore les profondeurs comme on tourne les pages d’un livre en ruine. Chacune des 17 strates qui le composent fonctionne comme une variation sur un même motif : de la compacité, de la verticalité, de la résistance. Certaines couches évoquent des cavernes végétales à la géométrie mouvante, d’autres des ruines industrielles rongées par les spores. Il y a du Metroid Prime dans cette topographie sourde, du Subnautica dans la densité des interstices, et parfois même du Journey to the Center of the Earth dans le souffle narratif diffus, l’impression de découvrir un monde effacé plus que de progresser dans un niveau.
L’exploration, ici, n’est jamais mécanique. Elle est texturée. Le joueur n’avance pas pour cocher une carte, mais pour satisfaire une intuition. Une courbe dans le relief, un changement d’éclairage, une matière plus friable : autant de signes, d’appels, qui déclenchent l’envie de creuser. Ce geste — creuser, littéralement — devient une syntaxe. Et le plaisir qu’il procure est constant, presque hypnotique. Seule limite à cette logique : au-delà de la vingtaine d’heures, certaines séquences — notamment dans les strates inférieures — peuvent perdre en variété, comme si le jeu peinait à renouveler pleinement ses situations sans réutiliser des canevas familiers.
Là où bien des exclusivités Nintendo cherchent l’effusion, Bananza opte pour la retenue. Le récit ne s’impose pas. Il s’installe. Pauline, retrouvée dans un cristal dormant, n’est ni compagne bavarde ni tutrice invisible. Elle est une présence spectrale qui s’active par le chant. Chaque transformation est réveillée par sa voix. Chaque artefact majeur se déploie dans sa résonance. Elle ne commente pas. Elle module. Son chant est un outil autant qu’un message, une vibration dans l’espace qui déclenche plus qu’elle ne signifie.
La relation entre Donkey Kong et Pauline ne s’écrit pas dans les dialogues — il n’y en a pas. Elle se devine dans les silences, les regards, les synchronisations d’actions. En solo, elle est gérée par l’IA, mais intelligemment. En coop, elle devient un vecteur ludique fascinant : chacun dépend de l’autre sans pouvoir le remplacer. Une belle idée, mais qui n’est pas sans aspérités. Dans certaines configurations — enfants, joueurs novices —, les interactions peuvent devenir désordonnées, voire involontairement punitives : un coup mal placé, une plateforme détruite trop tôt, et c’est tout un segment qui s’écroule. Une tension, parfois réjouissante, parfois accidentelle.
Le système de Banandium Gems constitue l’axe principal de progression. Ces cristaux, cachés ou récompensant des défis, servent à alimenter un arbre de compétences structuré autour de pôles : exploration, force, repérage, efficience des transformations. Mais ici, pas de “tout débloquer”. Chaque choix est exclusif. Investir dans la précision, c’est abandonner la brutalité. Opter pour la durée, c’est renoncer à l’impact. Et cette rigueur crée un sentiment d’engagement rare : on ne construit pas un build, on forge une manière de jouer. Ce parti pris renforce la valeur de l’exploration. Chaque gemme devient un choix latent, chaque amélioration, une ligne. Il ne s’agit pas de devenir plus fort, mais de devenir plus clair sur sa manière d’habiter le jeu.
Les combats de Bananza ne cherchent pas la flamboyance. Ils cultivent une tension d’usure. Les ennemis sont souvent des obstacles plus que des adversaires. Ils encerclent, ils forcent à réagir, à creuser ailleurs. L’arsenal est limité, mais précis : coups directs, roulades, frappes chargées, interactions élémentaires. Certains boss émergent, plus complexes, bâtis sur des schémas de transformation. Mais même là, le jeu refuse l’esbroufe. Le danger est dans le terrain, dans l’épuisement des ressources, dans l’impossibilité de reculer. Le joueur doit faire avec ce qu’il a. Il ne prépare pas un combo. Il s’ajuste, il survit. Quelques affrontements, bien que solides mécaniquement, manquent néanmoins de souffle dramatique ou de singularité, et l’on aurait parfois aimé qu’ils portent davantage le récit.
La bande-son, dirigée par Naoto Kubo avec des réarrangements de David Wise, est contemplative sans être éthérée. Les nappes sont rares, souvent réduites à quelques accords suspendus. On y entend des souffles, des frottements, parfois un écho lointain de thème connu — détimbré, ralenti, comme oublié. Pauline, par son chant, introduit des motifs plus aigus, presque cristallins. Elle ne rythme pas. Elle appelle. Elle active le monde comme une onde. Loin de flatter, la musique structure le silence. Et ce silence, justement, devient une surface d’inscription. Le joueur y projette sa propre écoute, ses attentes, ses doutes. Peu de jeux de cette ampleur acceptent de se taire autant.
Sur Nintendo Switch 2, Bananza démontre ce que la console peut offrir de mieux en matière de cohérence technique. Le moteur voxelisé tourne en 60 FPS constants, y compris dans les zones les plus denses. Les destructions sont fluides, les transitions entre couches instantanées. La caméra, bien que parfois prise en défaut dans des couloirs trop serrés, reste globalement stable. On observe toutefois, dans quelques séquences de boss ou d’effondrement massif, de brèves chutes de framerate — jamais pénalisantes, mais sensibles à l’œil attentif.
Le jeu n’exploite pas encore les solutions d’upscaling les plus récentes (DLSS absent, recours à un FSR discret), mais compense cela par une direction artistique lisible et un rendu voxel clair, sans surcharge. Les quelques bugs signalés sont mineurs, et ne perturbent jamais la continuité de l’expérience. Le jeu exploite pleinement la puissance de la console sans jamais en faire un argument. Il se contente d’être fluide, dense, vivant. Et c’est assez.
Il y a des jeux qui tentent de prouver leur valeur. Et d’autres qui, sans rien promettre, s’installent. Donkey Kong Bananza est de ceux-là. Il ne cherche ni à flatter ni à éblouir. Il propose. Il offre une structure claire, un plaisir dense, une proposition esthétique tenue. Il invente une manière d’habiter l’espace, de l’éroder, de le lire en creux. Il offre une coop subtile mais risquée, un silence habité, une progression exigeante sans jamais être punitive.
Ce n’est pas un jeu de rupture. C’est un jeu de maturité. Et c’est précisément cette retenue qui en fait l’un des jeux les plus solides, les plus élégants et les plus utiles au lancement d’une console. Donkey Kong Bananza n’est pas seulement un bon Donkey Kong. C’est une pierre fondatrice pour la Switch 2. Un point d’ancrage. Une raison suffisante, déjà, de faire le saut.