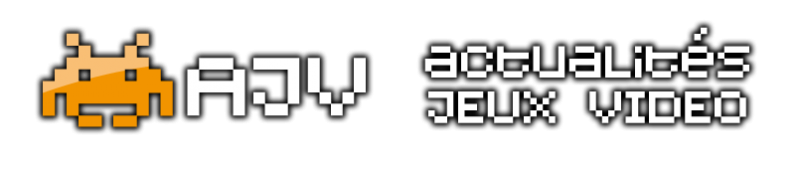Dying Light: The Beast
Il y a des séries qui vous sculptent la mémoire musculaire. Je me souviens encore du premier Dying Light, de son parfum de bitume chauffé au soleil et de sa verticalité grimpée au couteau, du frisson des nuits à Harran quand la peur vous cloue dans une remise décrépite, lampe éteinte, à compter votre souffle. Je me souviens aussi de Dying Light 2 Stay Human, de ses fulgurances, de son ambition gargantuesque, mais aussi de son monde parfois trop dilué pour son propre bien. C’est avec ce bagage que j’ai abordé Dying Light: The Beast sur PC — en terrain connu, certes, mais prêt à ce que Techland me surprenne. Et à ma grande satisfaction, ce standalone respire la lucidité. Il compresse les bonnes idées, taille dans le gras, assume une identité de survival-horror nerveux où la brutalité du corps-à-corps, l’angoisse nocturne et la mobilité restent les trois piliers, tandis que la narration exhumant Kyle Crane s’autorise davantage de franchise que d’emphase.
https://difmark.com/r/DyingLightTheBeastSteamAccount5991
Profitez de 10% de réduction avec le code « DIFMARK » !
On entre dans The Beast par une porte que les fans n’osaient plus espérer franchir : le retour de Kyle Crane, ce revenant qui porte désormais dans sa chair le tiraillement entre l’homme et l’infecté. Techland ne dissimule ni le fan service ni l’envie d’en faire un moteur dramatique. Cela commence comme un film de vengeance à l’ancienne, tout en cicatrices et en brusqueries, avec un antagoniste — le Baron — esquissé avec plus de promesses que de réelle substance. Le méchant existe surtout comme principe actif, catalyseur des obsessions et des séquelles du héros, mais la mise en scène a le bon goût de ne pas faire semblant : on embrasse l’arche classique, on l’exécute sans indulgence inutile, puis on laisse les seconds rôles et les quêtes annexes apporter la chair émotionnelle. C’est là que le jeu retrouve ce sens du détail que j’aimais tant à Harran : des histoires brèves, parfois poignantes, des rencontres qui s’installent sans crier gare et se referment avec une élégance simple, sans se croire obligées de vous expliquer la fin du monde. La campagne principale file droit, presque trop parfois, mais elle gagne en tenue ce qu’elle perd en lyrisme : elle sait où elle va, accélère quand il faut, freine quand les nuits s’étirent et que les volatiles vous obligent à raser les murs.
Tout cela, naturellement, ne tiendrait pas sans une grammaire de jeu capable de remettre les pendules à l’heure. Le combat est l’endroit où The Beast dévore ses prédécesseurs. La mêlée est épaisse, lourde, volontiers ignoble. Les os craquent, les membres cèdent, les postures d’ennemis blessés racontent quelque chose d’âpre, et l’arsenal blanc – lames, masses, impros bricolées – rappelle que la série n’a jamais rien eu à prouver côté sensations. La grande nouveauté, c’est la « bête » que Crane trimballe, cette jauge qui, une fois libérée, transforme un affrontement à l’agonie en minute de furie calibrée. On appuie sur le bouton de survie comme on reprend une respiration après apnée : ce n’est pas un fantasme de toute-puissance, plutôt un sursaut de chair et d’ongles. Les animations de finition sont volontairement outrancières, mais leur lisibilité n’est jamais sacrifiée ; elles s’insèrent dans le flux au lieu de le casser. À l’inverse, certaines capacités secondaires de la Bête sentent le gadget. On s’y amuse le temps d’un sourire, puis l’on revient à l’essentiel : une panoplie compacte et l’art de choisir le bon moment pour renverser l’issue d’une mêlée.
Les armes à feu font un retour assumé, plus net que dans Stay Human, sans écraser le reste. Elles claquent comme il faut et sauvent une rencontre mal embarquée, mais Techland a l’intelligence d’en limiter la facilité : les munitions se comptent, chaque salve attire davantage d’ennemis, et, surtout, vider un chargeur ne vous rapproche pas de la frénésie bestiale. Résultat : la hiérarchie reste claire. La mêlée est le cœur, la pétarade l’appoint. Cet équilibre, doublé d’une gestion de l’endurance moins généreuse qu’autrefois, donne au jeu un ton résolument « survivor » que je salue : on ne danse pas, on boxe ; on n’exécute pas un ballet, on s’extirpe d’un guêpier, l’épaule en feu, en calculant la prochaine fenêtre.
Reste le mouvement, l’autre grand langage de Dying Light. Ici, Dying Light: The Beast signe un compromis qui fera parler. Le parkour est magnifique quand l’environnement s’y prête : fluidité retrouvée, surfaces mieux signifiées, rythme organique de prises et de sauts qui réveille immédiatement les réflexes acquis à Harran. Mais Castor Woods, ce nouveau terrain de chasse, n’est pas une ville tentaculaire. C’est une vallée alpine, hachée d’espaces forestiers, de hameaux touristiques, de zones marécageuses, de poches urbaines compactes. La verticalité s’y offre à la manière d’un relief plutôt que d’une mégalopole : elle existe, parfois éclatante, mais elle se présente par à-coups. Entre deux quartiers denses on roule, et certains y verront une entorse à l’ADN « freerun ou rien ». La conduite a le mérite d’ouvrir le paysage, mais n’a jamais la noblesse mécanique d’un vrai jeu de véhicules ; elle demeure utilitaire, presque prosaïque. On en vient à regretter un soupçon de densité supplémentaire dans quelques zones centrales pour prolonger la grande respiration du parkour. Le grappin, lui, retrouve sa place, plus exigeant dans son timing, utile sans être une béquille. Certaines critiques le jugeront trop envahissant ; je l’ai vu plutôt comme un outil qui se mérite, qui sanctionne l’à-peu-près au profit du geste net. Seul bémol réellement irritant : la propension de certains infectés à vous agripper avec une assiduité qui casse le flux. Ce tic d’ergonomie, sur clavier-souris, frictionne plus qu’il ne devrait et donne envie d’un réglage de fréquence un peu plus subtil.
La nuit, en revanche, est une leçon. Les volatiles rôdent avec une férocité qui rappelle combien la série a toujours su tenir ses promesses d’horreur. On y ressort cette vieille panoplie de précautions — souffle court, pas feutrés, lumière ménagée — et l’on comprend vite que l’avidité du gain d’expérience ne compense pas toujours le risque. Les chasses qui s’ensuivent sont des parenthèses d’adrénaline pure, où chaque carrefour devient un choix tactique, chaque corniche un refuge improbable. Ce sont ces séquences-là qui, à mes yeux, justifient à elles seules l’existence de The Beast : elles distillent l’essence de Dying Light sans fioritures.
L’architecture du monde accompagne cette philosophie. Castor Woods n’essaie pas de rivaliser par la superficie, mais par la densité. On revient aux fondamentaux : des activités choisies parce qu’elles produisent du sens — postes d’alimentation à reconquérir, convoi à piller, zones obscures à nettoyer, caches à débusquer — et non parce qu’un cahier des charges réclame un quota. Dans cette économie de moyens bien pensée, les quêtes secondaires brillent. Elles n’ont pas besoin de renverser la mythologie pour exister : un conflit de voisinage qui tourne au drame, un survivant trop fier qui demande de l’aide sans le dire, un morceau de journal trouvé qui donne envie de fouiller plus loin. C’est simple, mais ciselé. On ne se noie plus dans les marqueurs, on suit un instinct d’explorateur, et l’on constate — luxe rare — qu’on se déplace si volontiers que le voyage rapide apparaît superflu une bonne partie de la partie.
La dimension coopérative, signature de la licence, tient ses promesses sans se réinventer. Rejoindre une partie est rapide, la progression des quêtes se partage proprement, les soirées à quatre refont le monde en riant entre deux décapitations. Sur les missions d’histoire, une corde invisible contraint la dispersion, histoire d’éviter que l’un se perde dans un marécage quand les autres déclenchent une cinématique. Ce « tether », discret mais réel, ne gêne pas l’essentiel. Ce qui gêne davantage, c’est l’absence de jeu entre plateformes au lancement : à l’heure où les communautés se mélangent sans effort, être cantonné à son écosystème reste une limitation archaïque. S’ajoute un détail d’immersion qui fera sourire autant qu’il agacera les puristes : quatre Kyle dans la même cinématique, c’est pratique, mais cela sonne faux. On s’y fait — l’ivresse du chaos coopératif fait le reste —, mais on aurait aimé un effort cosmétique pour mitiger ce petit accroc.
Côté musique et bruitage, The Beast confirme la sensibilité de la série. La partition d’Olivier Derivière habille l’espace sans le saturer, reprend ce mélange d’électro pulsée et de motifs plus sombres, presque respiratoires, qui soulignent la fuite autant que la lutte. Le travail sur les coups, les chairs, les impacts est remarquable : on ressent un poids, une matérialité, une désagréable précision dans le craquement d’un radius ou la bave d’un rôdeur. La direction artistique n’a pas la flamboyance d’une vitrine hollywoodienne, mais elle sait poser un climat. Les intérieurs éclairés à la lueur d’un néon malade, les parkings souterrains inondés, les belvédères qui s’ouvrent sur des forêts tachées d’orange au crépuscule, tout cela compose un écrin solide pour les mécaniques.
Reste l’épineuse question PC, que beaucoup de productions contemporaines traitent comme une variable d’ajustement. The Beast arrive avec davantage de sérieux que la moyenne, mais pas sans faux pas. Sur une machine équipée pour, la fluidité est au rendez-vous et la stabilité générale inspire confiance. Toutefois, il faut parler des saccades qui apparaissent quand la mémoire vidéo se fait chiche : les configurations modestes verront poindre ces hoquets désagréables lors de changements de zones ou d’effets lourds, signe qu’une gestion plus fine du cache aurait fait du bien. Les préréglages graphiques manquent un brin d’écart visuel — on aimerait que chaque palier affiche un vrai saut qualitatif —, et l’absence d’options de lancer de rayons au lancement surprend, tant la communication moderne a habitué à l’inverse. Cela ne condamne pas l’image, loin s’en faut ; l’éclairage global reste agréable, la perception des volumes convaincante, et l’on profite d’un mode à large plage dynamique qui, bien réglé, donne une profondeur appréciable aux nuits. Les technologies de mise à l’échelle proposées par les trois grands acteurs du GPU rendent de fiers services : elles achètent des images par seconde sans dégrader la netteté autant qu’autrefois et permettent de lisser une expérience parfois capricieuse. On note aussi quelques micro-accoups même sur des configurations musclées ; limiter le nombre d’images par seconde à une valeur stable aide à lisser la sensation. Quant aux bugs, j’ai croisé de l’inoffensif — PNJ coincé, texture têtue — et l’éternel souci contextuel réglé par un rechargement ; rien qui n’entame vraiment l’envie de repartir arpenter la vallée. Un correctif de premier jour vient déjà calmer les plus criants et laisse espérer un suivi régulier, domaine dans lequel Techland a fait ses preuves par le passé.
Si l’on parle de valeur, The Beast a la pudeur de ne pas brader votre temps. La campagne, tenue, se boucle dans une grosse quinzaine d’heures si vous filez droit, davantage si vous accordez à Castor Woods l’attention qu’elle mérite. Cette durée, loin de frustrer, paraît cohérente avec l’ambition du projet : c’est une coupe nette dans l’excès de Stay Human, une manière de rappeler que l’édition, l’art de choisir ce qu’on enlève, compte autant que le volume. On ressort de ces heures avec l’impression d’avoir vécu un arc complet, un chapitre qui sait se fermer, sans pour autant clouer le cercueil des expérimentations futures. En cela, The Beast ressemble à une saison spéciale d’une série que l’on aime : elle n’a pas la prétention du grand final, mais capte une tonalité, recentre un héros, clarifie une proposition.
Faut-il pour autant épargner ce qui fâche ? Non. L’histoire principale traîne une banalité que même un montage nerveux ne gomme pas complètement. Le Baron ne marque pas l’imaginaire, et l’arc émotionnel de Kyle, bien qu’efficace, s’autorise peu de nuances. Quelques combats de boss oscillent entre chorégraphies inspirées et sacs à points de vie qui cassent le rythme. La verticalité, dès qu’on sort des poches urbaines, manque à ceux qui avaient fait de Harran une aire de jeu aérienne. Le grappin divisera, la conduite restera utilitaire, et le système d’ennemis qui s’accrochent avec trop de zèle grignote parfois la fluidité tant chérie par la série. Sur PC, enfin, l’optimisation pourrait mieux différencier ses niveaux de réglages, accepter de montrer qu’elle a du coffre quand on lui donne de quoi respirer, et offrir plus tôt les options visuelles attendues.
Mais si je mets ces réserves à plat, c’est précisément parce que le reste se tient. Ce que Dying Light: The Beast réussit, il le réussit avec une conviction qui fait plaisir. Le corps-à-corps est une démonstration. La nuit remet la peur au centre. Le monde, plus ramassé, offre un terrain d’expression idéal à la boucle « explorer, risquer, piller, s’équiper, recommencer ». Les quêtes secondaires redonnent du sens à la flânerie. La coop injecte ce qu’il faut de camaraderie et de folie. Et la figure de Kyle, mine de rien, boucle un cercle que Stay Human avait laissé ouvert. Le jeu parle à la mémoire musculaire sans sombrer dans l’auto-citation, propose à ceux qui ont aimé la licence de la retrouver en meilleure compagnie, débarrassée de son emphyseme open world.
Dans la grande fresque des jeux d’action en monde ouvert, Dying Light: The Beast n’est pas un manifeste technologique ni une révolution formelle. C’est un rappel au réel : l’exécution compte plus que la promesse, la cohérence plus que l’étalage. J’aurais aimé un antagoniste plus mordant, un soupçon de verticalité supplémentaire sur la carte, un système d’agrippes moins intrusif ; j’aurais aussi aimé que la version PC affiche, dès les premières heures, toutes les options visuelles qu’on attend d’elle. Malgré cela, je sors de The Beast avec l’impression d’avoir retrouvé ce que Dying Light avait de plus précieux : une science de la mobilité contrainte, une brutalité sincère, un goût du risque qui n’a pas cours ailleurs. The Beast n’est pas un appendice, encore moins une rédemption : c’est une mise au point. Elle rappelle à Techland ce qu’il sait faire de mieux et à nous autres pourquoi nous aimons cette licence — pour ces instants où l’on arrache une victoire improbable au milieu d’une rue que la nuit a dévorée, pour ce mélange de peur et de jubilation quand la bête affleure et que, l’espace d’une minute, c’est nous qui chassons. Dans un paysage saturé d’open worlds formatés, cette franchise retrouve ici son sillon : resserré, incisif, viscéral. C’est une bonne nouvelle pour la série, et une meilleure encore pour ceux qui, comme moi, n’ont jamais oublié la sensation du premier saut sur un toit trop loin.