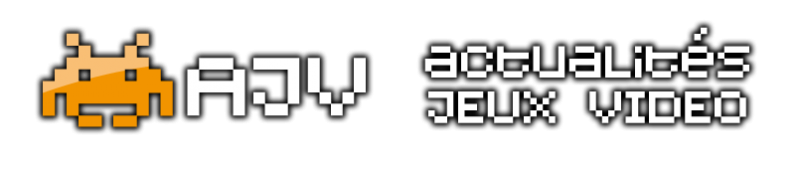Ghost of Yōtei
Il est des studios qui, à force de patience et d’obstination, affinent leur langage jusqu’à surprendre sans brusquer. Sucker Punch fait partie de ceux-là. Avec Ghost of Tsushima, je m’étais laissé emporter par une direction artistique somptueuse, une mise en scène habitée par le cinéma de samouraïs, un système d’exploration guidé par le vent d’une élégance rare et des duels au katana dont la netteté n’a pas quitté ma mémoire. Ghost of Yōtei, qui arrive plusieurs siècles plus tard dans un Japon septentrional plus austère, n’a pas la tentation de faire table rase de cette grammaire. Il la reprend, la resserre, l’endurcit, lui greffe des idées qui paraissent évidentes une fois manette en main. Le résultat n’est pas une révolution mais une épure, un jeu qui assume sa filiation tout en imposant une personnalité franche, plus âpre, parfois plus intime, souvent plus sûre d’elle.
https://difmark.com/r/GhostofYoteiPS5Account5933
Profitez de 10% de réduction avec le code « DIFMARK » !
Cette personnalité tient d’abord à son cadre. Hokkaidō, la montagne Yōtei à l’horizon, les champs balayés par des vents glacials, les cendres volcaniques qui rosissent l’air, la neige qui amortit les sabots et le pas d’Atsu : tout concourt à un sentiment de bord du monde. La carte ne se livre pas d’emblée ; on la déchiffre comme un carnet que l’on remplirait à mesure de ses propres curiosités. La longue-vue, petite trouvaille d’apparence modeste, change la posture du joueur. On scrute, on annote, on transforme des silhouettes lointaines en rumeurs, puis en lieux tangibles, et l’on se surprend à tracer soi-même des itinéraires plus crédibles que n’importe quel fil d’Ariane lumineux. Le vent, toujours, sert de boussole diégétique ; les oiseaux dorés, que j’avais aimés sur Tsushima, reviennent mais de manière plus mesurée, réglables pour ne pas surcharger l’écran d’intentions. Cette manière d’encourager le regard plutôt que le point d’exclamation est l’une des réussites majeures du jeu : l’exploration semble moins orchestrée, plus organique, plus confiante, et lorsqu’un bosquet, un pan de falaise, une vapeur d’onsen rompent la monotonie d’un trajet, cela ressemble à une trouvaille plutôt qu’à une case à cocher.
Le récit, lui, s’invite dans ce territoire avec la simplicité d’une légende noire. Atsu, héroïne marquée par le deuil, se fabrique une iconographie d’onryō, esprit vengeur devenu presque méthode. Sa liste, les Six de Yōtei, structure l’aventure comme un collier aux perles inégales, que l’on peut aborder dans un ordre partiellement libre, au gré des indices récoltés. Cette liberté relative n’est pas un gadget : elle conditionne l’itinéraire, le rythme, les rencontres, et elle confère au jeu un air de traque où l’on devine en permanence des ramifications latérales. Sucker Punch a le bon goût de ne pas surécrire le mystère. Les motivations d’Atsu sont d’une limpidité qui n’empêche ni la nuance ni l’émotion. Elle n’a pas la noblesse programmée de Jin Sakai ; elle a son entêtement, sa rudesse, ses silences. Son arc fonctionne parce qu’il épouse la physicalité de l’exploration et la cadence des affrontements ; il se nourrit de rencontres qui l’endurcissent autant qu’elles l’éclairent. On pourra trouver que certains antagonistes ne dépassent pas leurs archétypes ; c’est vrai, parfois, lorsque la mise en scène accélère et privilégie l’efficacité. Reste que l’ensemble, sans coups de théâtre artificiels, tient par une qualité de jeu d’acteurs et une précision d’écriture qui, à défaut de renouveler le genre, l’honore.
Là où le jeu s’impose, c’est dans la manière dont il fait dialoguer système et atmosphère. La boucle exploratoire — observer, rassembler des bribes d’informations, marquer la carte, s’équiper, repartir — a la simplicité robuste d’une bonne routine. Les activités annexes font écho au décor sans l’écraser : les coupes de bambou existent encore, les bains apaisent toujours l’œil et le verbe, mais elles cohabitent avec des gestes plus terre-à-terre, plus artisanaux, qui ancrent Atsu au territoire. C’est beau parce que c’est humble, et cela dit quelque chose de ce que le jeu veut raconter : non pas la naissance d’un symbole national, mais la traversée d’une femme qui se reconstruit en avançant.
À l’heure de combattre, le système reprend les acquis de Tsushima et les approfondit là où il fallait. Le cœur des affrontements reste lisible et tranchant, avec cette austérité chorégraphique qui rend chaque échange de coups intelligible. Mais la panoplie a pris de l’épaisseur. On jongle plus volontiers entre les familles d’armes, des lames légères à l’ōdachi qui cisaille les gardes, de la yari qui tient l’ennemi à distance à la kusarigama qui invite à un tempo différent ; le jeu n’en fait pas un cirque d’entrées-sorties, il incite à choisir les bons outils, à sentir quand une garde lourde appelle un contournement, quand un assaillant lointain légitime de dégainer l’arc ou la poudre, quand le grappin change la verticalité d’un duel. Ce n’est pas seulement un catalogue, c’est une palette, et l’on passe d’une nuance à l’autre avec une plus grande confiance qu’auparavant. Les duels demeurent un point d’orgue, moins pour leur difficulté intrinsèque que pour leur mise en scène, ce sens du silence avant l’impact, ces cadrages qui veulent inscrire la mémoire du coup juste. La furtivité, de son côté, ne sert pas d’excuse à la facilité : elle est viable, parfois préférable, jamais obligatoire. Le jeu sait ménager des situations où l’on accepte de devenir ombre, sans pour autant transformer chaque campement en puzzle mécanique.
Tout n’est pas indiscutable pour autant. Comme souvent, la caméra, lorsqu’on la brusque contre un obstacle ou qu’un ennemi vient griffer le hors-champ au mauvais moment, accuse de petites raideurs. Les collisions, rares mais notables, surgissent précisément quand le rythme s’emballe ; elles ne ruinent pas l’expérience mais rappellent la fragilité d’un équilibre pourtant soigné. L’intelligence artificielle, sans être ridicule, se révèle plus remarquable par sa lisibilité que par ses ruses ; à haut niveau d’équipement, certains combats perdent un soupçon de tension. Le jeu compense en multipliant les configurations, en variant les pressions, en rendant la menace collective plus tangible, mais on sent ici ou là que la mécanique privilégie la clarté au détriment de l’imprévu.
La structure générale, articulée autour des Six de Yōtei, a ce mérite de supporter un rythme que le joueur module à sa guise. On peut courir de piste en piste, resserrer l’étau sur une cible en quelques heures, ou au contraire se perdre dans une chasse aux indices qui s’ouvre sur de nouvelles amitiés, des mentors, des histoires locales qui n’ont pas besoin d’être grandiloquentes pour être mémorables. C’est là que la comparaison avec Tsushima devient intéressante : le souffle épique est moins frontal, moins monumental, et pourtant je me suis souvent surpris à préférer ce registre, à apprécier la manière calme et confiante dont le jeu me laissait construire ma propre géographie, mon propre récit de vengeance. Le revers de cette liberté est connu : à force de multiplier les détourages, certaines activités prennent un air de redite. Le jeu limite la sensation de grind par l’habileté avec laquelle il relie l’utile au curieux, mais n’échappe pas, par moments, à la fatigue structurelle du monde ouvert.
Techniquement, l’ensemble tient le rang et, à plus d’un titre, progresse. Les chargements sont d’une discrétion presque indécente : on se surprend à plier une mort en duel et à revenir au monde avant d’avoir ravalé sa vexation. La DualSense est utilisée avec intelligence, non pour faire vibrer à tout-va mais pour donner à la matière un grain lisible : la tension d’une corde, l’accroche d’un fer dans le gel, la résonance sourde d’un coup qui passe la garde. L’audio 3D a le bon goût d’orienter sans cabotiner ; il aide l’oreille à sentir une approche, à deviner une flèche, à distinguer les profondeurs d’un ravin avant que l’œil ne corrige. Sur le plan graphique, le jeu propose le duo attendu entre qualité et performance, avec des déclinaisons qui exploitent la machine de manière convaincante. L’image gagne en propreté et en stabilité, l’éclairage profite d’effets plus subtils qui donnent aux intérieurs une densité crédible, aux scènes nocturnes une lumière qui n’écrase pas les noirs. Sur les machines les plus récentes, l’accent mis sur une reconstruction d’image plus fine et sur un traçage de rayons plus ambitieux rehausse la perception générale sans trahir l’identité picturale. Rien de tout cela n’est miraculeux ; tout paraît posé, assumé, parfois perfectible. Il arrive que des micro-saccades se glissent entre deux panoramas lorsqu’on traverse des zones denses, il arrive que certaines textures secondaires jurent par leur sobriété. Ce sont des accrocs mineurs dans une tapisserie autrement remarquable.
La direction artistique, justement, est le vrai soc de la charrue. Ghost of Yōtei a conservé de son aîné le sens de la composition et l’a réorienté vers un Nord plus rêche. Les palettes s’ouvrent aux gris bleutés qui entaillent la peau, aux rouges sourds qui tachent les roches, aux jaunes pâles des graminées qui s’aplatissent sous la neige humide. Les saisons semblent avoir été conçues comme des états d’âme ; elles modulent l’espace autant que la couleur, elles sculptent la traversée. Le jeu sait quand il faut abandonner le grand spectacle pour laisser parler la matière : le souffle, la poudre, la bruine. Les modes cinématographiques, héritiers assumés des hommages rendus par Tsushima, reviennent sans posture nostalgique. Ils offrent des filtres et des traitements de l’image qui, utilisés avec parcimonie, réinterprètent le plan plutôt qu’ils ne le pastichent. On peut y voir un caprice esthétique ; j’y lis surtout un désir de garder en tête la dette — immense et fertile — au cinéma japonais, tout en refusant d’aplatir le jeu sous une collection de clins d’œil.
La musique, ample sans emphase, a la délicatesse de s’effacer quand le cadre porte suffisamment et d’embrasser le plan lorsque l’émotion réclame un thème. J’ai aimé ces motifs qui s’infiltrent, plutôt qu’ils ne s’imposent, et qui donnent à Atsu une respiration propre. Le travail sur le son, au sens large, participe du même souci de justesse : les pas étouffés dans la neige, les tissus qui claquent sous la rafale, les cordes qui gémissent avant de céder, tout concourt à une présence, une forme de vérité sensible qui invite à ne pas consommer les scènes mais à les habiter.
Côté ergonomie et accessibilité, l’offre est sérieuse, même si certaines aspérités trahissent un chantier encore perfectible. Les options de lecture, de taille et de colorimétrie des sous-titres, l’ajustement des indications visuelles, les aides contextuelles au combat et en visée, les remappings qui évitent de transformer la mémoire musculaire en gymnastique punitive : rien ne manque à l’appel et l’on sent le studio soucieux d’ouvrir les portes. On regrettera que toutes les options ne s’installent pas avant la toute première cinématique et que quelques réglages gagneraient à encore plus de granularité ; l’essentiel est là, solide, utile, et l’on peut saluer l’effort sans cesser d’en vouloir davantage.
La comparaison directe avec Ghost of Tsushima mérite un peu de nuance. J’aimais la majesté solaire de Tsushima, ce sens du grand tableau qui imposait au regard une forme de noblesse. Yōtei préfère la respiration courte, les paysages moins riants, les lignes plus dures. Il y gagne une cohérence thématique, il y perd parfois cette immédiateté spectaculaire qui faisait de chaque crête un poster. Sur le plan mécanique, Yōtei est davantage un perfectionnement qu’une réinvention : l’exploration, désormais ancrée dans l’observation par la longue-vue et le système de rumeurs, tire le monde vers une crédibilité qui servait déjà Tsushima mais qui l’excède ; le combat, enrichi d’options et de transitions plus naturelles entre types d’armes, a trouvé un tempo plus assuré ; l’ensemble, techniquement mieux assis, s’accorde avec l’époque et le lieu choisis. On peut déplorer une forme de familiarité, ce sentiment que l’on connaît déjà le poème et qu’on en déguste aujourd’hui une strophe plus travaillée ; on peut aussi y voir la marque d’un studio qui refuse l’esbroufe et préfère polir sa pierre.
Un mot enfin sur l’horizon que le jeu se réserve. L’aventure solo se suffit pleinement à elle-même, mais la perspective d’un prolongement coopératif dans l’esprit de Legends a déjà le parfum de l’évidence tant la base mécanique, la variété des armes et la lisibilité des rôles se prêtent au jeu à plusieurs. Cela ne change rien à la qualité du présent, sinon à signaler une envie de durer qui siérait bien à cet univers.
Alors, que reste-t-il lorsque l’on referme le fourreau et que le vent retombe ? Un jeu d’une maturité rare, sans éclat inutile, qui sait ce qu’il reprend, ce qu’il corrige, ce qu’il assume de ne pas bouleverser. Un monde que l’on a vraiment appris plutôt que parcouru au radar. Une héroïne qui n’a pas besoin d’être sanctifiée pour être mémorable. Des combats qui perpétuent ce plaisir, toujours délicat, d’une lecture claire et d’une exécution exigeante. Des accrocs — caméra capricieuse, répétitions ici et là, antagonistes qui n’atteignent pas toujours la densité espérée, frémissements techniques isolés — qui ne pèsent jamais assez pour entamer l’évidence : Ghost of Yōtei est de ces épisodes qui ne cherchent pas à réécrire l’ADN de leur prédécesseur mais qui, par leur mesure et leur précision, en extraient une version plus sûre, plus droite, plus habitée. Sucker Punch n’a pas trahi Tsushima ; le studio a entendu ce que nous avions aimé et s’est demandé comment le rendre plus vrai. Au bout de cinquante heures, je n’avais plus l’impression de suivre un fantôme ; je croyais à la trace laissée par mes propres pas, et le mont Yōtei, obstiné dans sa blancheur, me paraissait moins un décor qu’un témoin silencieux. Dans un calendrier saturé de grandes promesses, cette fidélité à une idée — voir, avancer, trancher, se taire — a quelque chose de précieux. Et si l’on aime, comme moi, les jeux qui préfèrent la tenue à la frime, il y a ici de quoi combler durablement son besoin de grand air, de duels propres et d’horizons qu’on gagne à la force du regard.