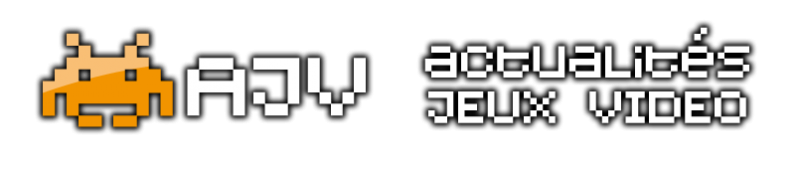Hades II
J’ai attendu. Sans fébrilité ostentatoire, mais avec une patience têtue, presque superstitieuse. J’avais adoré Hades premier du nom et je savais ce que Supergiant Games était capable d’offrir lorsqu’un projet est poli jusqu’au dernier éclat. Alors j’ai laissé passer l’accès anticipé, préféré ignorer les sirènes de la curiosité pour rencontrer Hades II dans son état final, celui qu’un studio de perfectionnistes considère comme la vérité de son œuvre. Et me voilà devant la version 1.0 sur PC, à la fois reconnaissant et exigeant, prêt à vérifier si la promesse de grandeur qui a longuement mijoté tient, cette fois encore, dans la main comme une arme parfaitement équilibrée. La réponse, sans se presser, arrive d’abord par une sensation : celle de revenir en territoire connu et pourtant transformé, comme si le temple avait été reconstruit pierre par pierre pendant la nuit.
https://difmark.com/r/HadesIISteamAccount2802
Profitez de 10% de réduction avec le code « DIFMARK » !
Ce retour ne se contente pas de changer de protagoniste. Mélinoé n’est pas une Zagreus au féminin ; c’est une héroïne sorcière, déterminée et vulnérable, qui inscrit d’emblée le jeu dans une autre tonalité. Là où le premier Hades tenait du roman d’apprentissage vibrant, la suite parle d’héritage, de guerres anciennes et de temps malmené, avec Chronos en figure d’ombre abrasive. Le récit s’installe par capillarité, à travers ces dialogues qui collent au run, ces apartés qui surgissent après une victoire comme après une défaite, cette manière, si propre à Supergiant, d’écrire non pas au-dessus du joueur mais avec lui. Pourtant, le ton, plus grave, affirme une distance : on sent une ambition historique, une cartographie du monde élargie, une dramaturgie moins intime. C’est un choix assumé qui donne à l’ensemble une ampleur que peu de roguelites osent revendiquer.
Sur le plan du combat, Hades II ne se contente pas d’ajouter des couches ; il réorchestre le cœur. Le trio d’actions — attaque, spéciale, incantation — est traversé par la logique des attaques « Oméga », ces versions canalisées qui consomment la ressource de magie et inaugurent un tempo inédit : charger, temporiser, relâcher. La magie, justement, devient le sang qui irrigue tout, circule salle après salle, dicte un souffle, oblige à penser la dépense comme une mise en scène. La refonte de l’incantation, ce cercle posé au sol qui enferme, ralentit, cadre et punit, recompose la lecture de l’espace. À l’arrivée, les affrontements ne vont pas seulement plus vite ; ils respirent mieux. On alterne les coups secs et les pauses menaçantes, les accélérations féroces et les fenêtres de punition intelligemment ménagées. Cette grammaire nouvelle donne au moindre couloir une intensité chorégraphique que l’on ne ressentait pas à ce niveau dans l’épisode précédent.
Cette profondeur ne tient pas qu’à l’arsenal, même si les armes conservant chacune leur identité — rythmes, portées, contreparties — sont travaillées avec une précision de luthier. Elle se nourrit de la générosité des dieux, dont les dons esquissent des architectures de jeu sensiblement plus variées. On retrouve quelques signatures familières, mais la galerie s’ouvre et, avec elle, des archétypes moins évidents : l’empoisonnement par le feu qui se propage à retardement, le marquage d’une cible pour la transformer en maillon faible d’une chaîne punitive, la lumière qui compresse l’espace pour créer une zone d’exécution. Loin d’une inflation confuse, ces directions dessinent des silhouettes nettes : le run de contrôle, patient, qui immobilise et coupe ; le run de percussion, qui crée des fenêtres d’explosion ; le run d’attrition, qui ronge et attend la chute. On s’amuse à chercher la faille, à improviser des convergences, et ce sentiment, si rare, que peu de tentatives sont « perdues » dès les premières salles, s’impose comme un principe de design.
Il faut s’arrêter un instant sur la manière dont Supergiant agence le temps long. La progression méta procède ici par paliers réfléchis. L’Autel des Cendres structure des gains solides sans verser dans le baroque, les souvenirs à équiper redonnent aux affinités une utilité ludique lisible et les familiers, loin de n’être qu’une coquetterie, deviennent de vrais leviers tactiques. Les outils de récolte, eux, installent un cycle un peu plus terrien : l’exploration n’est pas uniquement faite de combats, mais de prélèvements, de retours à la base, de préparations. Au tout début, cette logique peut sembler une digression, surtout pour celles et ceux qui n’aiment pas voir la route barrée par un réservoir de ressources trop étroit. Pourtant le système s’ouvre, cède, alimente la boucle sans l’enliser. Le studio ne renie pas la sensation de l’effort ; il la transforme en habitude gratifiante, où chaque session laisse une trace concrète.
La grande trouvaille structurelle, on le sait désormais, tient à l’existence de deux routes complètes. L’Underworld et la surface ne se contentent pas d’être deux décors : ce sont deux philosophies de déplacement, deux cartographies de danger, deux dialectes de la même langue. Les biomes doublent la variété de silhouettes ennemies et de micro-décisions de navigation, les salles s’aèrent ou se resserrent selon la zone, l’architecture impose de repenser ses timings. On sent à quel point le studio a pris plaisir à contredire nos automatismes : des boss conçus comme des scènes musicales où la lisibilité n’est jamais sacrifiée à l’esbroufe, des mini-boss qui forcent la mobilité, des assemblages d’ennemis qui testent la gestion de foule plutôt que les réflexes bruts. La célèbre sensation de « run vivant » du premier jeu s’épanouit ici parce que le monde a cessé d’être un corridor : il devient un réseau.
À l’histoire, le jeu réserve un soin qui confine à l’obsession. Chaque retour à la base est l’occasion d’un échange qui n’aurait pu exister sans le run précédent, chaque personnage progresse non pas sur un rail, mais au gré de ces croisements, parfois heureux, parfois contrariés, que le hasard des tentatives fait naître. Le studio, maître dans l’art de la ligne unique qui tombe juste, parvient à prolonger la magie du premier épisode : on lit, on sourit, on hausse les sourcils, et l’on se surprend à chercher un ultime combat simplement pour mériter une réplique supplémentaire. Le final, enfin présent dans cette version 1.0, referme la boucle avec élégance. On discutera entre passionnés de savoir si l’impact émotionnel atteint la grâce plus intime de Zagreus ; personnellement, j’y vois un autre climat, une gravité assumée qui sied à la figure de Chronos et à la géographie élargie du monde. Moins de confessionnal, plus d’épopée : c’est une mue cohérente.
Reste la question, cruciale, de la difficulté et du rythme. Hades II se montre plus âpre dans ses premières heures, surtout lorsqu’on s’aventure trop tôt vers des zones qui exigent un niveau de lecture plus élevé. C’est une âpreté sereine, sans cruauté gratuite : les patterns punissent l’approximation, mais récompenseront deux fois l’attention. Le système optionnel qui adoucit la courbe pour qui en a besoin — héritage direct du premier épisode — est toujours là, simple à activer, progressif, respectueux. L’équilibrage, globalement, force à considérer l’incantation et la magie comme des piliers et non des agréments ; il pousse le joueur à vivre avec ses fenêtres de vulnérabilité plutôt qu’à les nier. C’est plus exigeant, parfois plus frontal, mais l’ivresse qui accompagne une réussite est à cette aune : elle vous appartient davantage.
Je ne saurais parler d’Hades II sans évoquer ce qui, chez Supergiant, tient presque du manifeste : la direction artistique. Le trait de Jen Zee, reconnaissable entre mille, travaille la silhouette avant la texture, la couleur avant l’effet. Chaque dieu est une idée en mouvement, chaque ennemi une icône lisible, chaque décor une variation de lumière. L’œil n’est jamais noyé, même lorsque la scène s’embrase de particules et de chocs. Les couleurs, souvent plus contrastées que dans le premier, découpent des plans logiques ; l’interface, épurée, s’autorise seulement ce qu’elle doit dire. Et la musique, signée Darren Korb, vient coudre l’ensemble. Elle ne sature jamais, glisse de riffs lourds en arpèges suspendus, rappelle parfois explicitement que le combat est une danse plus qu’un duel. Les morceaux thématiques consacrés à certaines rencontres, notamment, font partie de ces instants où l’on comprend que le plaisir vient d’un tout indissociable.
Techniquement, la version PC sur Steam respire la maîtrise. Le lancement est rapide, les options vidéo sont claires et suffisantes pour s’adapter aux machines modestes comme aux configurations plus ambitieuses, et l’on bénéficie d’une latence en main qui ne trahit jamais l’intention. Manette ou clavier-souris, l’ergonomie répond avec précision, et la lecture de l’action ne pâtit pas d’un affichage à la traîne. J’apprécie que le jeu n’oublie pas l’hygiène élémentaire du confort : remappage convenable, lisibilité des textes, indications sobres. Rien ici ne vole la vedette au jeu lui-même et c’est très bien ainsi, car le moindre temps mort serait une faute de goût.
On en revient à la densité. Hades II déborde, au point que l’on pourrait craindre le trop-plein. Le studio a choisi de dérouler ses systèmes par étapes, de laisser respirer la découverte, de faire de la base un lieu qui ne se contente pas d’être un hub mais une respiration narrative. Pourtant, par moments, cette générosité frôle l’empilement. On peut ressentir une légère fatigue à l’idée de courir après des ingrédients précis pour débloquer tel pan d’amélioration, surtout lorsqu’un mauvais alignement d’aléas s’obstine. De même, la multiplication des embranchements mécaniques peut diluer un brin la pureté élémentaire qui faisait l’évidence du premier Hades. Ce sont des réserves mesurées, des nuances plus que des reproches, et, dans l’économie du jeu, elles se dissolvent vite dans le plaisir de l’expérimentation.
La rejouabilité, elle, tutoie l’indécence. Deux routes qui se répondent, une table de dons sensiblement élargie, des armes qui se réinventent sous l’effet de styles et d’améliorations, une foule d’événements qui continuent à surgir bien après les premières victoires, et un endgame qui ne se contente pas d’augmenter des chiffres mais modifie la physionomie des combats : tout concourt à prolonger le désir. On ne revient pas seulement pour faire mieux ; on revient pour faire autrement. Le jeu donne ce sentiment rare de croissance qualitative : ce n’est pas tant votre avatar qui monte en puissance que votre propre lecture qui s’affine, et la satisfaction qui en découle, cette sorte de compétence sensible, demeure la marque des grands.
Je pourrais étirer encore le chapitre sur l’écriture, tant il s’y niche de petites merveilles. Les personnages secondaires ne sont pas des cautions mythologiques posées sur une étagère brillante ; ce sont des partenaires de scène qui, par une inflexion de voix, par une ligne qui percute, stabilisent l’équilibre délicat entre tragédie et malice. Les romances, discrètes ou plus frontales selon la route de chacun, apportent un grain humain sans que la quête ne perde son axe. On ressent, dans cette mise en scène du quotidien des Enfers, dans ces allers-retours de nouvelles alliances, que Supergiant a encore aiguisé sa capacité à parler d’action en parlant de personnes. Le combat n’est jamais un interlude entre deux dialogues ; il est la conversation elle-même.
On me demandera sans doute si Hades II « dépasse » Hades. La question est légitime et, à bien des égards, la réponse est oui : il est plus ample, plus varié, plus grand de corps et d’esprit. Mais il le fait d’une manière qui refuse la redite automatique. Plutôt que de simplement élargir la carte, le jeu redéfinit les règles du déplacement. Plutôt que d’empiler des effets, il introduit une ressource — la magie — qui redonne une métrique au temps. Plutôt que d’alléger le récit pour faire place au système, il choisit l’épopée et en assume la gravité. Est-ce au prix d’une légère perte de netteté émotionnelle par rapport à la confession délicate de Zagreus ? Peut-être. Est-ce un compromis acceptable pour frôler la synthèse que peu de studios savent composer aujourd’hui ? Pour moi, oui.
À l’heure de conclure, je reviens à ce que j’attendais : un chef-d’œuvre d’orfèvrerie ludique, où chaque rouage compte, où la beauté ne masque jamais l’ingénierie, et où l’audace n’excuse pas l’approximation. Hades II, dans sa version 1.0 sur PC, est précisément cela. Il est la preuve qu’une suite peut prolonger un héritage sans le figer, déplacer le centre de gravité sans briser l’équilibre, et offrir au genre un nouvel étalon sans surjouer l’iconoclasme. J’y ai trouvé une œuvre sûre d’elle, exigeante et généreuse, qui respecte le temps du joueur autant qu’elle dialogue avec lui. Et si quelques aspérités subsistent — une entrée en matière un peu plus rude, une abondance de systèmes qui, par instants, s’emmêle — elles n’entament jamais le verdict qui s’impose au fil des heures : nous tenons un grand jeu, une pièce maîtresse du roguelite contemporain, et l’une des rares suites capables de faire grandir son modèle sans éclipser son souvenir. On ne pouvait guère espérer mieux ; on ne pouvait surtout pas espérer autre chose de Supergiant.