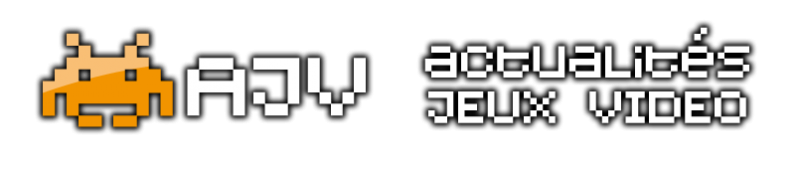Mafia: The Old Country
On commence toujours par une ombre. Non pas celle qu’un personnage projette sur une ruelle de pierre, mais celle d’une époque qui revient à la vie. Mafia: The Old Country ne cherche pas à nous persuader que nous sommes l’élu d’une fresque héroïque ; il nous installe dans une Sicile rude et poussiéreuse, où la légitimité se mendie et se paye. La première impression n’est pas une scène d’exposition, mais une sensation : la blancheur écrasante d’un après-midi, le poids des murs, le claquement sec d’une lupara qui brise un silence trop long. La question n’est pas « que raconte le jeu ? », mais « jusqu’où accepte-t-il de regarder son propre mythe sans fard ? ». Car derrière le folklore mafieux si souvent travesti par le cinéma, Hangar 13 tente une chose simple et difficile : donner la densité d’un monde qui n’a pas besoin de nous, puis nous demander ce que nous sommes prêts à lui céder pour y exister.
https://difmark.com/r/MafiaTheOldCountrySteamAccount1512
Profitez de 10% de réduction avec le code « DIFMARK » !
C’est dans ce déplacement que s’installe toute la mise en scène. On n’incarne pas un héros auréolé, mais Enzo Favara, un homme dont le nom pèse moins que la place qu’il tente de gratter dans la vallée des Dorata, territoire clos où chaque pierre est déjà prise. Le jeu ose ici une dimension sociale rarement explorée : la mine de soufre, la dureté des journées, les premières revendications syndicales. La mafia n’est plus seulement un clan folklorique, mais une structure parallèle née du vide institutionnel. Les dialogues esquissent plus qu’ils n’expliquent, se taisent quand il le faut, confient aux regards ce qu’une réplique écrite ne dirait jamais. Les personnages secondaires existent par un geste, un rire hors de propos, un « basta » qui claque comme un couperet. La reconstitution refuse l’encyclopédie, préfère l’impression juste : l’odeur du cuir mouillé, le grain des murs, le crépitement d’une procession nocturne. Le doublage intégral en sicilien ne s’offre pas comme une curiosité exotique, mais comme un socle culturel qui oblige à apprivoiser l’accent, le protocole, la lenteur. Rien ne nous tend la main. Cette économie de mots, ce refus du spectaculaire facile, confèrent au récit une présence presque documentaire, où la dramaturgie se loge dans l’épaisseur des instants plutôt que dans la flamboyance des événements.
Cette exigence narrative innerve aussi la structure. La progression reste une ligne, découpée, resserrée. Chaque mission est un dispositif précis, rarement ouvert à l’improvisation totale. On observe, on contourne, on force parfois, mais l’ossature demeure : infiltration contrainte, tir à couvert, duel qui tranche le rythme. L’Explore, accessible dès le départ, respire comme un sas : un temps pour acheter, repérer, traverser des villages serrés et des oliveraies vallonnées. Mais cette enclave, aussi belle soit-elle, reste plus contemplative qu’interactive. On attend du Free Ride promis qu’il élargisse l’espace, qu’il délie les coutures. Pour l’heure, la promenade est cadrée, musée vivant où l’on collectionne autant des traces que des trophées. La vie entre les missions existe, mais elle ne possède pas encore l’épaisseur d’un monde qui réagit à notre passage.
C’est dans cette logique resserrée que s’inscrit la campagne, qui assume une brièveté d’une douzaine d’heures, davantage si l’on explore. Peu d’embranchements spectaculaires, une rejouabilité qui tient plus dans la discipline qu’on s’impose que dans des systèmes émergents. Pas de microtransactions déguisées : seulement quelques cosmétiques, un artbook et une bande-son en édition Deluxe. Pour certains, le contenu semblera mince au regard du prix ; pour d’autres, cette densité concentrée vaut mieux qu’un monde ouvert dilué.
Le jeu nous apprend d’abord à nous taire. À longer un couloir, à écouter un pas qui s’éloigne, à sentir la crispation d’un silence qui pourrait se briser. La furtivité n’est pas décorative : elle impose discipline et patience, joue sur des cônes de perception clairs, des bruits qui voyagent, des pièces qui résonnent. Sa netteté se paie cher : un faux mouvement, et l’élan se brise net, laissant le joueur partagé entre tension et sanction. Quand enfin le silence éclate, c’est par des armes sobres et lourdes, sans pyrotechnie, juste une onde courte qui domine l’espace avant de s’éteindre. Les fusillades trouvent leur logique dans des couvertures lisibles, des diagonales travaillées, une IA capable d’élans brusques autant que de routines figées. Et puis, trop souvent, vient la lame. Le duel au couteau, thématiquement impeccable, cherche un équilibre fragile entre parade et initiative. Ses premières apparitions électrisent, muettes et intimes ; sa répétition finit par user, émousser la tension qui l’habitait. Ce qui avait la force d’un rite devient par moments une habitude.
La sobriété s’étend à l’économie du jeu. Une seule lame à ménager, à affûter, à remplacer. Pas d’arsenal démesuré, mais une contrainte à apprivoiser. Les dinari se gagnent dans l’effort et s’échangent contre du matériel ou des charmes accrochés au chapelet d’Enzo, qui modulent légèrement le destin. La progression n’empile pas des chiffres ; elle affine un style, épure les gestes. Les missions obéissent à la même logique : intérieurs qui serrent, extérieurs qui promettent plus qu’ils n’offrent, patios aux regards croisés. La vallée est un piège lent, une attente dilatée. Parfois, le jeu s’autorise un éclat — un opéra, une procession détournée, une poursuite nocturne — mais retombe vite dans une retenue qui préfère la contrainte à la démesure. On peste devant des checkpoints avares qui rallongent la peine d’une minute de trop, ou devant un retour brutal sur rails quand on déborde le cadre. Mais on salue un marquage discret, une signalisation modulable qui n’écrase jamais le sens de l’orientation. Même les véhicules, cheval ou voiture, s’inscrivent dans ce choix : non comme systèmes expansifs, mais comme motifs qui participent au monde sans le transformer en terrain de jeu.
Sur PC, cette austérité se double d’une exigence technique. Unreal Engine 5, Lumen, upscaling généralisé, génération de trames : tout est là, mais tout demande un réglage attentif. En 4K Épique, même les configurations musclées peinent à maintenir 60 images constantes ; l’équilibre se trouve souvent ailleurs, en 1440p High avec un upscaler en mode Quality. En 1080p, la fluidité s’installe, mais certaines scènes denses rappellent les limites du streaming d’assets. Les solutions d’upscaling jouent chacune leur partition avec leurs compromis, et le HDR respire à condition d’être ajusté. Hautes textures, SSD rapide, micro-stutters ponctuels : rien d’infamant, mais un monde qui exige concessions et patience. Les correctifs rapides au lancement ont montré un suivi attentif, et le DRM quotidien, discret une fois validé, ne trouble pas l’expérience.
La prise en main traduit la même rigueur. Clavier et souris trouvent vite leur inertie, avec un remapping complet et un FOV modulable. À la manette, la visée réclame quelques ajustements mais finit par convaincre. L’accessibilité dépasse le vernis : sous-titres paramétrables, filtres de couleurs, aides à la conduite, raccourcis pour éviter les trajets, HUD flexible. En ultrawide, via l’écran gaming AOC AGON PRO AG346UCD, le gameplay s’étire sans trahir l’immersion, même si les cinématiques résistent un peu. Et si l’image impressionne, c’est l’oreille qui scelle la mémoire. Les coups de feu claquent sans emphase, les lames s’entendent avant de se voir, les marchés crépitent, les intérieurs étouffent juste ce qu’il faut. Les voix trouvent leur équilibre : l’anglais nuance, le français retient, le sicilien enracine. La musique, discrète, encadre plus qu’elle n’impose, mais l’absence de titres sous licence prive certains de l’ancrage culturel attendu.
Alors, faut-il juger The Old Country pour ce qu’il n’est pas ? On pourrait réclamer plus de libertés, plus de systèmes, plus de réactions. Mais la cohérence de ce cadre ne fait pas de doute : ce n’est pas un bac à sable expansif, mais une fresque austère, tendue, qui impose son rythme. Ici, le monde ne se conquiert pas, il se négocie. Et ce qu’il propose — infiltration serrée, fusillades nettes, duels répétés — laissera forcément de la frustration. Mais il offre en retour une atmosphère rare, une densité d’instants qui demeurent une fois l’écran noir tombé, une élégance dans la contrainte.
On terminera comme on a commencé : par une ombre. Non pour douter, mais pour mesurer. Ce jeu ne courtise pas le consensus. Sur PC, il exige des réglages attentifs ; dans le geste, de la patience face à la furtivité et aux duels ; dans le récit, une écoute des silences. À qui cherche un blockbuster expansif gavé d’activités secondaires, il paraîtra étriqué, presque austère. À qui veut un spectacle flamboyant, il n’offrira que des murs trop proches et des ombres trop longues. Mais à qui accepte son rythme singulier, à qui préfère l’intensité d’un décor qui impose ses lois plutôt qu’un monde ouvert qui attend d’être domestiqué, il offrira une expérience concentrée, mémorable. Mafia: The Old Country est imparfait — ses duels surexploités, sa rigidité crispante, sa durée modeste en frustreront plus d’un. Mais il sait exactement ce qu’il veut être et le propose sans compromis. Pour certains, une déception ; pour d’autres, une victoire fragile mais inoubliable.