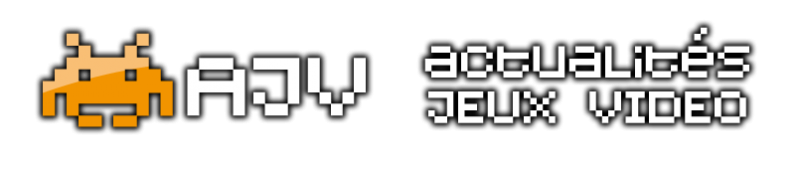Mandragora: Whispers of the Witch Tree
Derrière chaque arbre tordu, chaque ruine d’un monde en déclin, une question obsède : jusqu’où l’humanité peut-elle aller pour retrouver ce qu’elle a perdu ? Mandragora: Whispers of the Witch Tree, dernier-né de Primal Game Studio en collaboration avec Knights Peak, tente de répondre à cette interrogation lancinante à travers une fresque mélancolique et viciée, sortie le 17 avril 2025 sur PC. À l’heure où tant de jeux sombrent dans l’interchangeabilité, Mandragora se dresse comme une offrande à la fois brûlante et imparfaite, chargée d’ambition et de déchirements.
https://difmark.com/r/MandragoraSteamAccount9979
Profitez de 10% de réduction avec le code « DIFMARK » !
Mandragora n’est pas un jeu qui conte une histoire : il la laisse émerger, s’insinuer, se décomposer dans la conscience du joueur comme les spores d’un champignon noir. L’écriture, sans jamais sombrer dans l’exposition gratuite, distille ses bribes à travers les dialogues rétifs, les objets à demi-décrits, les murmures enregistrés dans les branches mêmes du décor. Le héros, silencieux et meurtri, n’est pas tant un protagoniste qu’un vecteur d’écho : sa quête, à la fois tragique et opaque, se conjugue à un passé que nul ne semble vouloir exhumer. La mémoire, ici, n’est pas un outil narratif mais un poison lent. Les figures secondaires, spectres d’un monde effondré, incarnent avec finesse les différentes facettes de la déchéance : la dévotion fanatique, le déni orgueilleux, la nostalgie brisée. Rarement un RPG n’a su conjuguer aussi habilement récit environnemental et arcs personnels. Certes, l’elliptisme assumé pourra frustrer, mais c’est justement dans ses silences que le jeu prend corps : dans ces instants où l’on découvre que l’arbre sacrifie ses fruits pour survivre.
Mandragora n’invente pas la roue : il la fait grincer d’une façon nouvelle. Son mélange de metroidvania, de RPG mélancolique et de dark fantasy assumée le distingue sans forcer l’exotisme. Là où tant de titres s’inspirent de Dark Souls ou Hollow Knight comme on copie un devoir, Mandragora détourne ces influences pour leur injecter une substance narrative propre, une lenteur habitée. Le système de « souillure », qui récompense la prise de risque par une perte progressive d’humanité, renverse l’équilibre habituel entre progression et pouvoir. De même, l’intégration de la magie non comme outil, mais comme dette, impose des choix lourds de conséquences. C’est dans ces détails que Mandragora affirme sa singularité. Difficile de ne pas penser à Blasphemous, Salt and Sanctuary, voire au premier NieR devant l’ambiance mortuaire et la rugosité du gameplay de Mandragora. Mais là où ces titres embrassent le grotesque ou l’absurde, Mandragora cultive la pudeur. Sa noirceur est plus feutrée, plus sourde, et sa mise en scène évoque davantage un conte noir qu’une parabole sanglante. Par rapport aux titres précédents de Primal Game Studio, c’est un bond qualitatif et conceptuel évident. Le studio abandonne ses expérimentations déconstruites pour proposer un monde systémique, un écosystème régénératif, en même temps qu’un acte d’auteur profondément incarné.
Le gameplay de Mandragora repose sur une tension constante entre fragilité et maîtrise. Le système de combat, exigeant mais lisible, s’articule autour d’un mélange subtil de rythme et de choix tactiques. Chaque affrontement devient un duel où la moindre erreur se paie en sang. On est loin d’une difficulté punitive arbitraire : ici, chaque défaite enseigne. Les classes disponibles, bien que peu nombreuses, bénéficient d’une profondeur tactique que l’arbre de compétences vient enrichir sans jamais diluer. Toutefois, certaines compétences passives tendent à dominer l’arsenal, rendant moins nécessaire l’expérimentation. De même, un menu rapide pour accéder aux capacités actives en combat ferait gagner en fluidité.
La progression, organique, récompense l’exploration et l’expérimentation. Le système de craft, fondé sur la collecte de ressources mutantes et déviantes, se distingue par une logique interne rigoureuse, mais son interface mériterait davantage d’ergonomie. La gestion des matériaux rares, parfois frustrante, tend à ralentir le rythme sans toujours enrichir le gameplay. Quant aux niveaux, ils illustrent une architecture ludique presque fétichiste : les raccourcis débloqués, les zones interconnectées, les portes qui s’ouvrent sur des impasses pleines de sens. Rien n’est gratuit, tout participe à un réseau de contraintes et de choix. La campagne principale, d’une trentaine d’heures, se suffit à elle-même sans jamais forcer l’allongement artificiel. Pourtant, l’univers pullule de quêtes secondaires à la structure non linéaire, souvent porteuses de conséquences tangibles sur l’équilibre du monde. Les embranchements, discrets mais significatifs, invitent à rejouer pour en percer les ramifications. Trois fins majeures, chacune porteuse d’une vision du sacrifice et de la rédemption, donnent à l’expérience un poids réflexif inhabituel. Le mode « Racines profondes », activable à tout moment, introduit des variantes systémiques qui renouvellent radicalement l’approche des combats et de la gestion de ressources. Il ne s’agit pas d’un simple mode difficile, mais d’une reformulation des règles du monde, où le temps, les saisons et la corruption deviennent des variables ludiques. On regrette toutefois l’absence d’un mode « Nouvelle partie + », qui aurait permis de prolonger davantage l’expérience sans redondance. Cette générosité de contenu n’est jamais univoque : elle s’inscrit dans une vision cohérente de la rejouabilité comme relecture.
Graphiquement, Mandragora frappe d’abord par sa texture : cette matière presque organique qui suinte de chaque surface, entre putréfaction et sublime. La direction artistique, délibérément baroque, convoque des influences picturales allant du symbolisme à Beksiński, sans jamais verser dans le maniérisme. Chaque environnement — forêt nécrosée, village dévitalisé, crypte végétale — semble être un personnage à part entière, porteur d’une histoire tue. Les effets de lumière, entre clair-obscur fuyant et phosphorescence maladive, ciselent l’ambiance avec une justesse presque douloureuse. Les animations, si elles manquent parfois de fluidité dans les transitions secondaires, brillent par leur expressivité lorsqu’il s’agit de combat ou de rites occultes. Toutefois, une certaine répétition visuelle d’ennemis dans des contextes variés (notamment quelques sous-boss) amoindrit par moments l’effet de découverte. Sur le plan technique, le jeu se montre étonnamment solide pour une production de cette envergure. Le framerate reste constant en 1440p, y compris dans les zones les plus densément peuplées d’effets et de particules. Les temps de chargement, bien que présents, s’insèrent naturellement entre les séquences d’exploration et ne cassent jamais le rythme. Quelques bugs mineurs — collisions hasardeuses, scripts de quêtes capricieux — parsèment l’expérience mais ne la compromettent pas. Le moteur maison, visiblement optimisé en profondeur, offre une réactivité exemplaire et une prise en charge impeccable des périphériques. L’absence de crash majeur ou de ralentissements critiques témoigne d’un soin rare porté à la finition. Mandragora n’est pas sans failles, mais il respecte le joueur par son intégrité technique.
L’univers sonore de Mandragora est une étreinte froide. La bande originale, composée par un collectif resté volontairement anonyme, évite les leitmotivs attendus pour préférer une progression modale, instable, parfois délibérément dissonante. Les nappes synthétiques s’entrelacent aux percussions primitives et aux instruments médiévaux détournés, créant un tissu sonore à la fois désorientant et mémorable. Chaque pas, chaque coup d’épée, chaque craquement de branche est rendu avec une précision presque chirurgicale. Le sound design ne se contente pas d’accompagner l’action : il l’anticipe, la renforce, la trahit parfois. Toutefois, le mixage audio mériterait un rééquilibrage : certaines voix, bien qu’interprétées avec sobriété, restent trop discrètes face à des effets sonores envahissants. Mandragora ne crie jamais. Il susurre.
Mandragora: Whispers of the Witch Tree est un jeu qui ne cherche pas à plaire, mais à marquer. Il en résulte une œuvre à la fois sublime et rugueuse, inégale par endroits mais toujours habitée d’une vision claire. Sa difficulté, son absence de concessions esthétiques, sa narration éparse et sa lenteur assumée ne conviendront pas à tous. Mais pour qui accepte de s’y enfoncer, de s’y perdre, Mandragora offre une des expériences les plus profondes et viscérales de cette génération. C’est un cri étouffé dans la forêt, un miroir obscur tendu au joueur. Et il m’a marqué durablement.